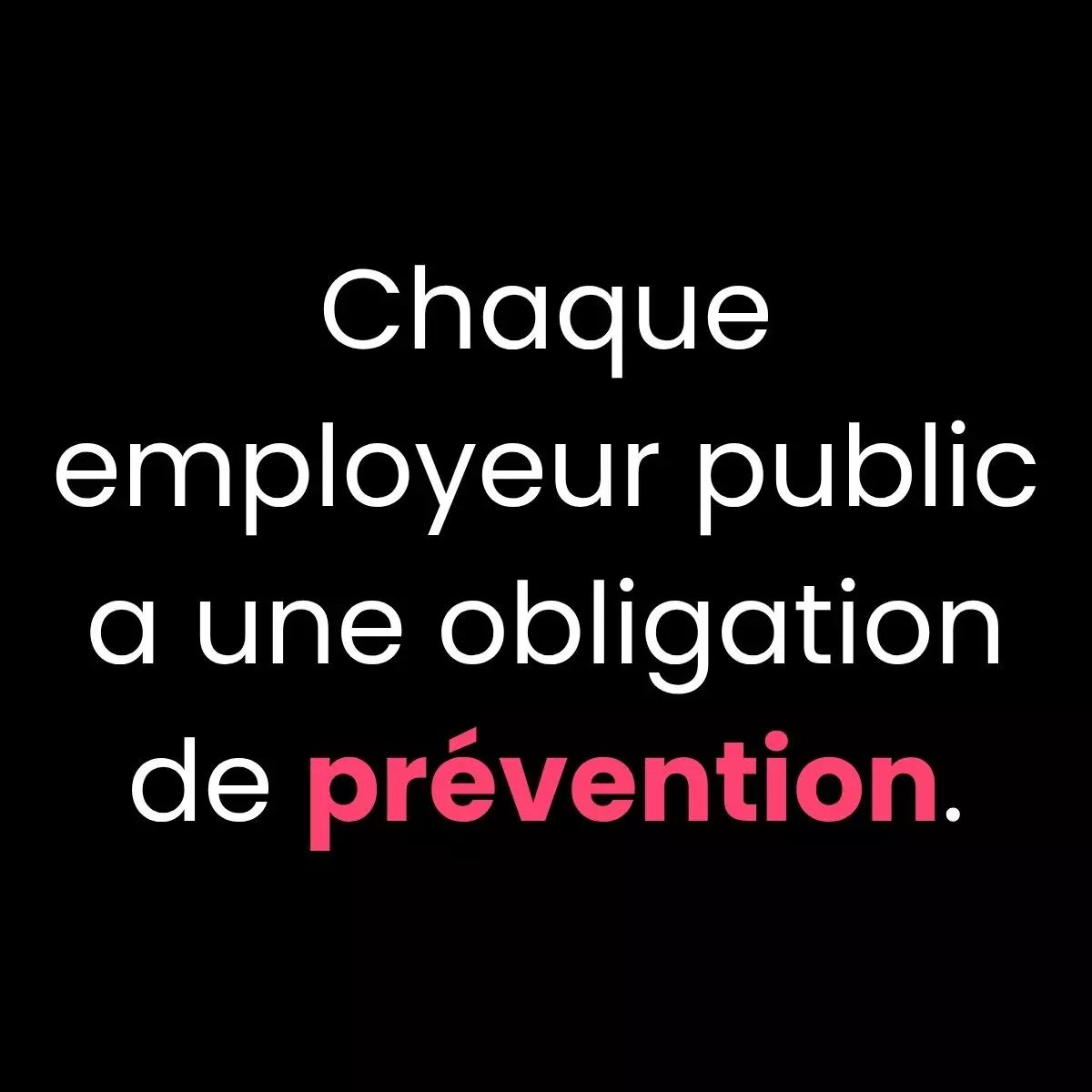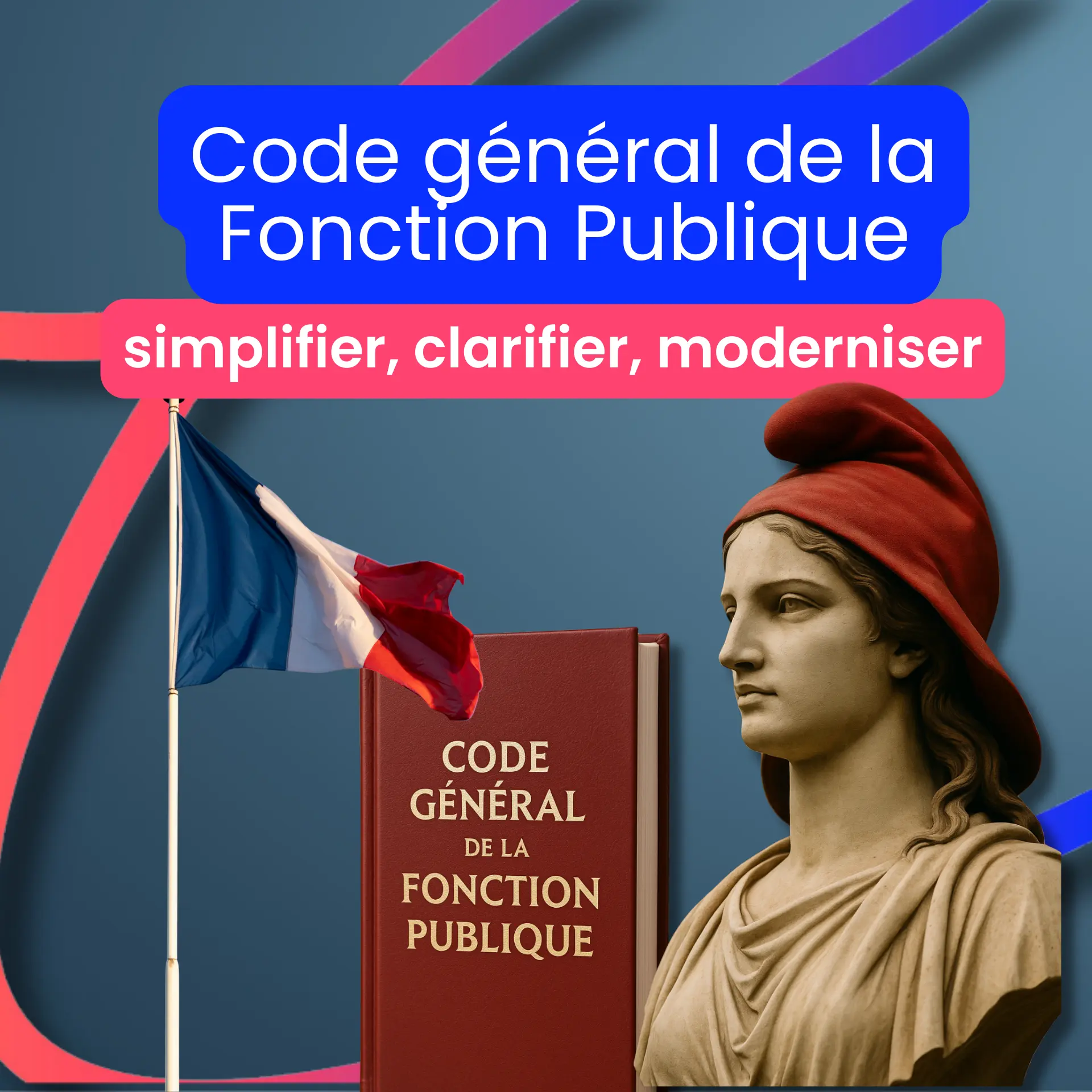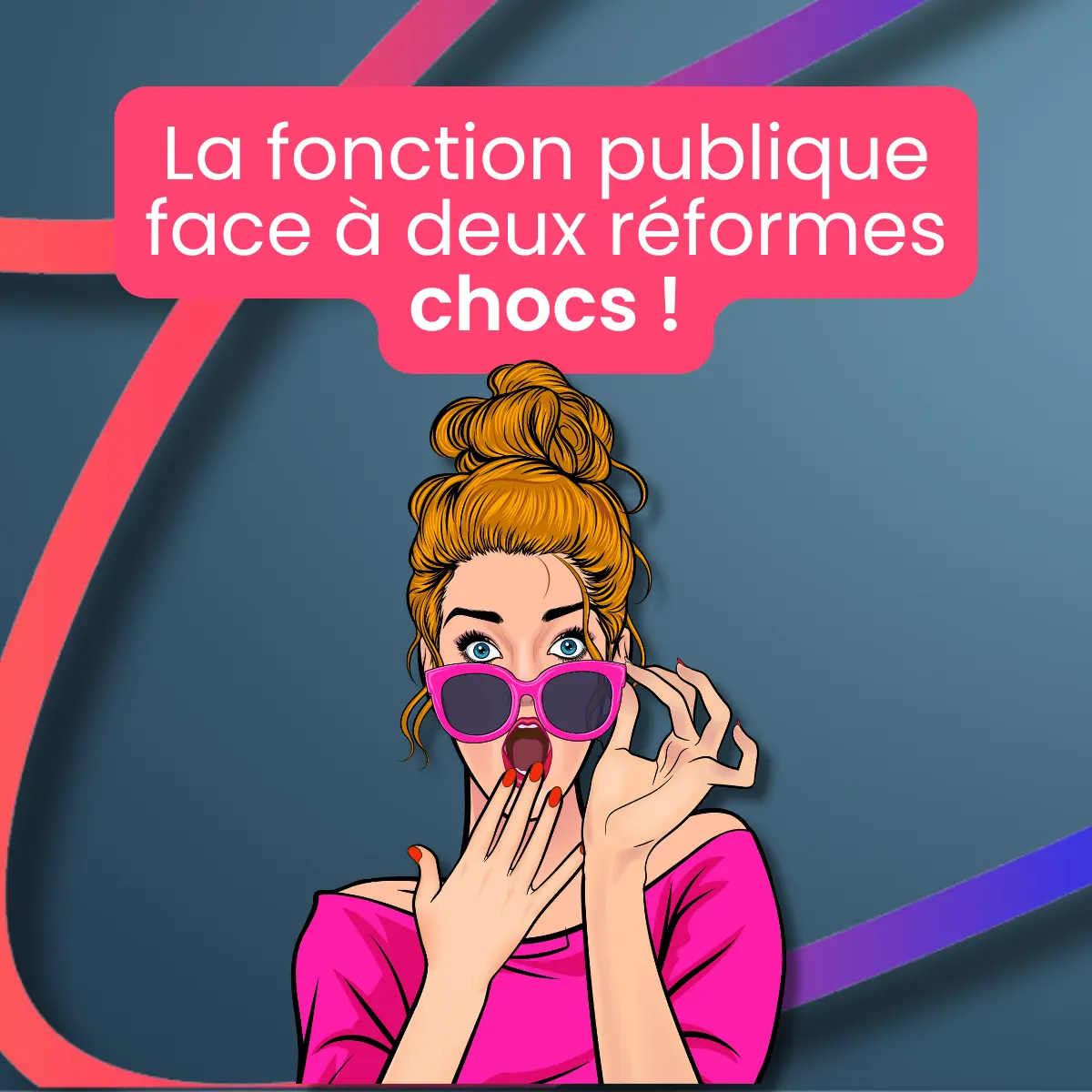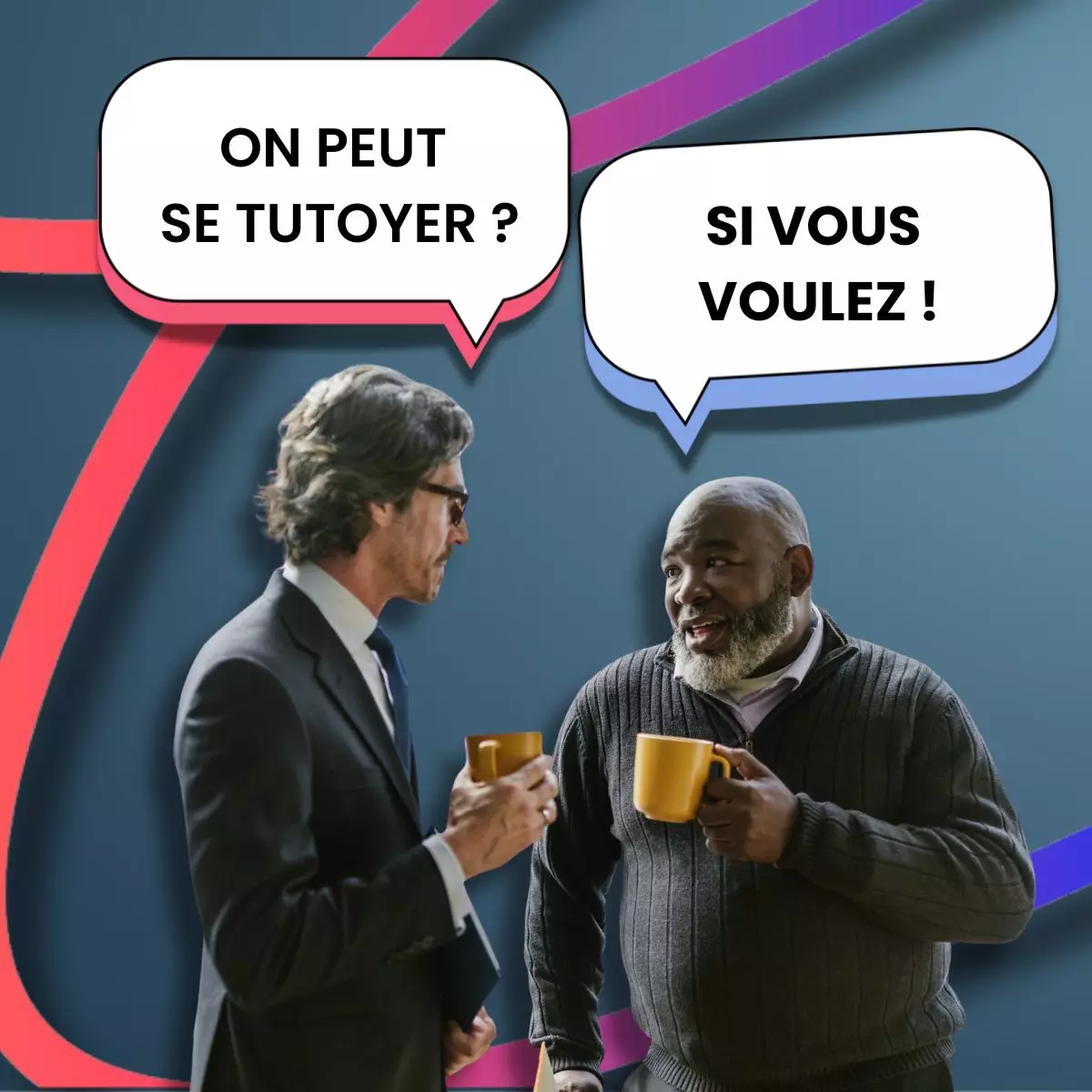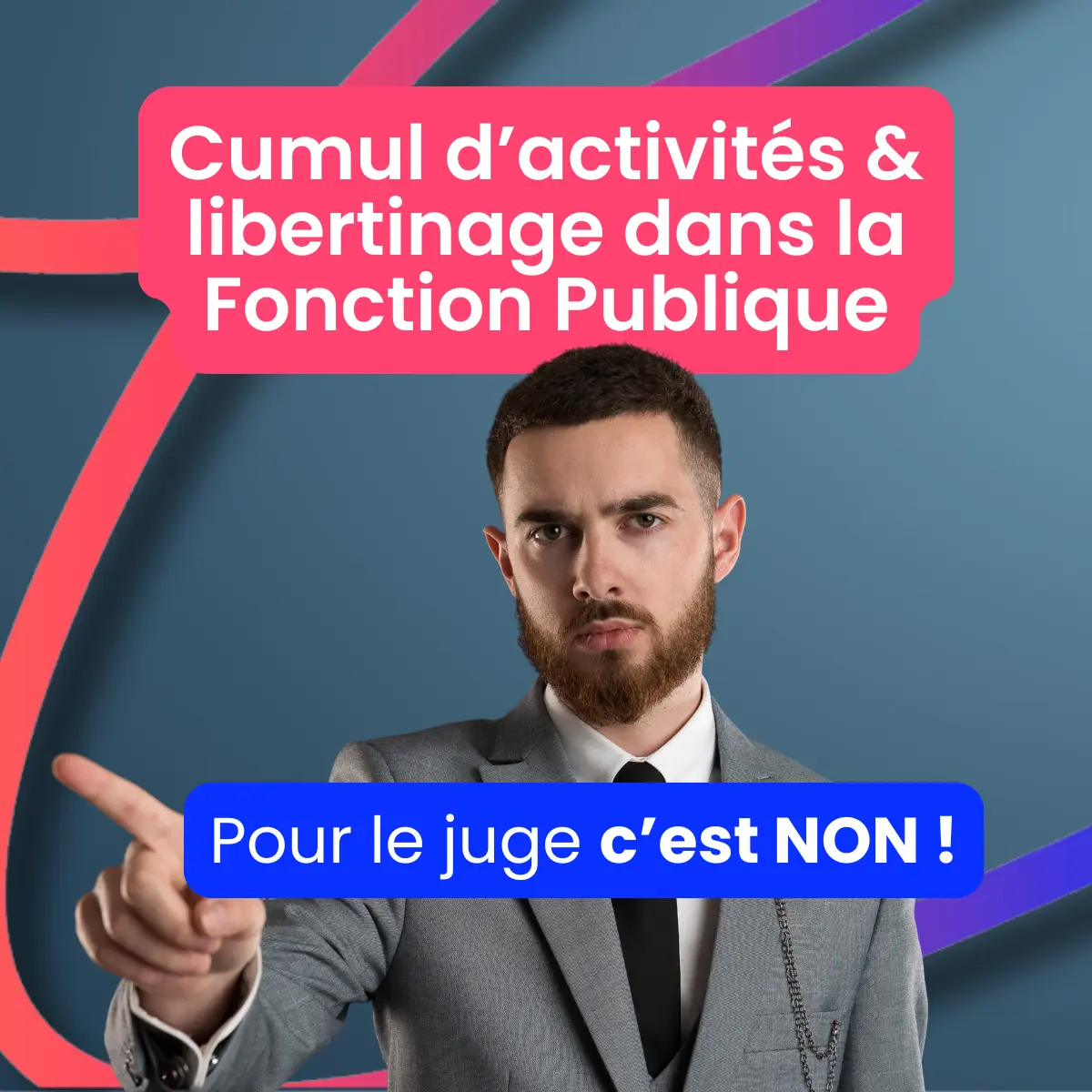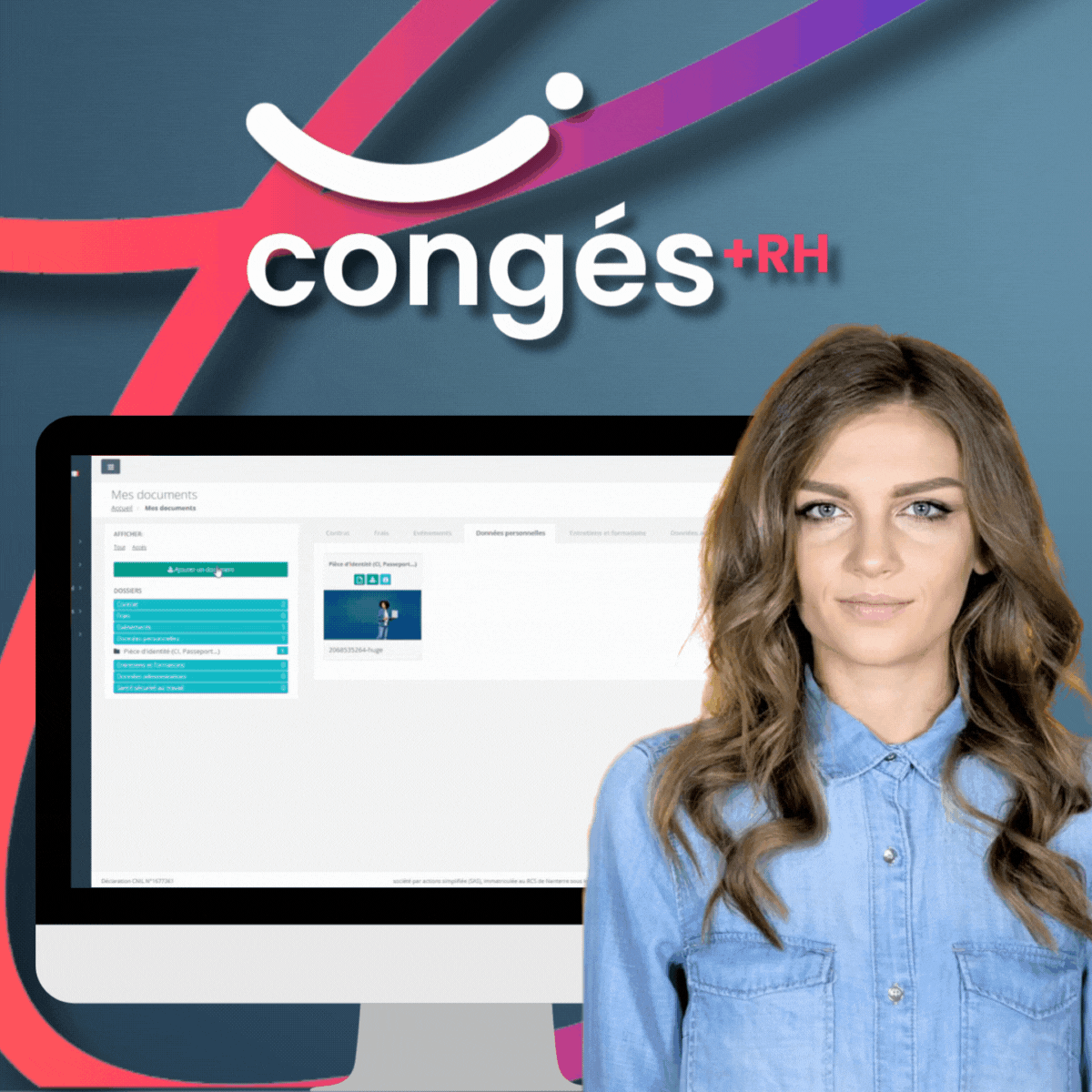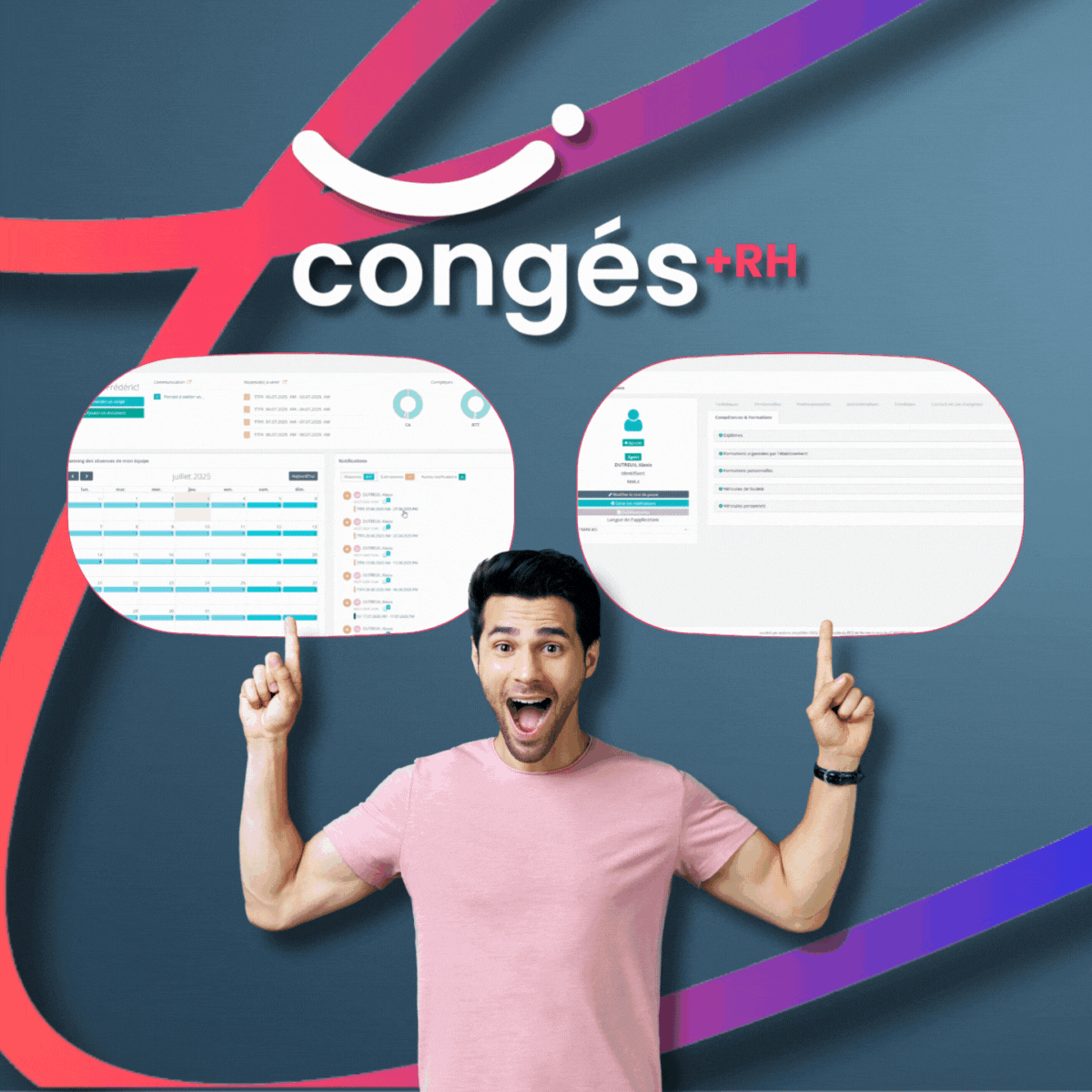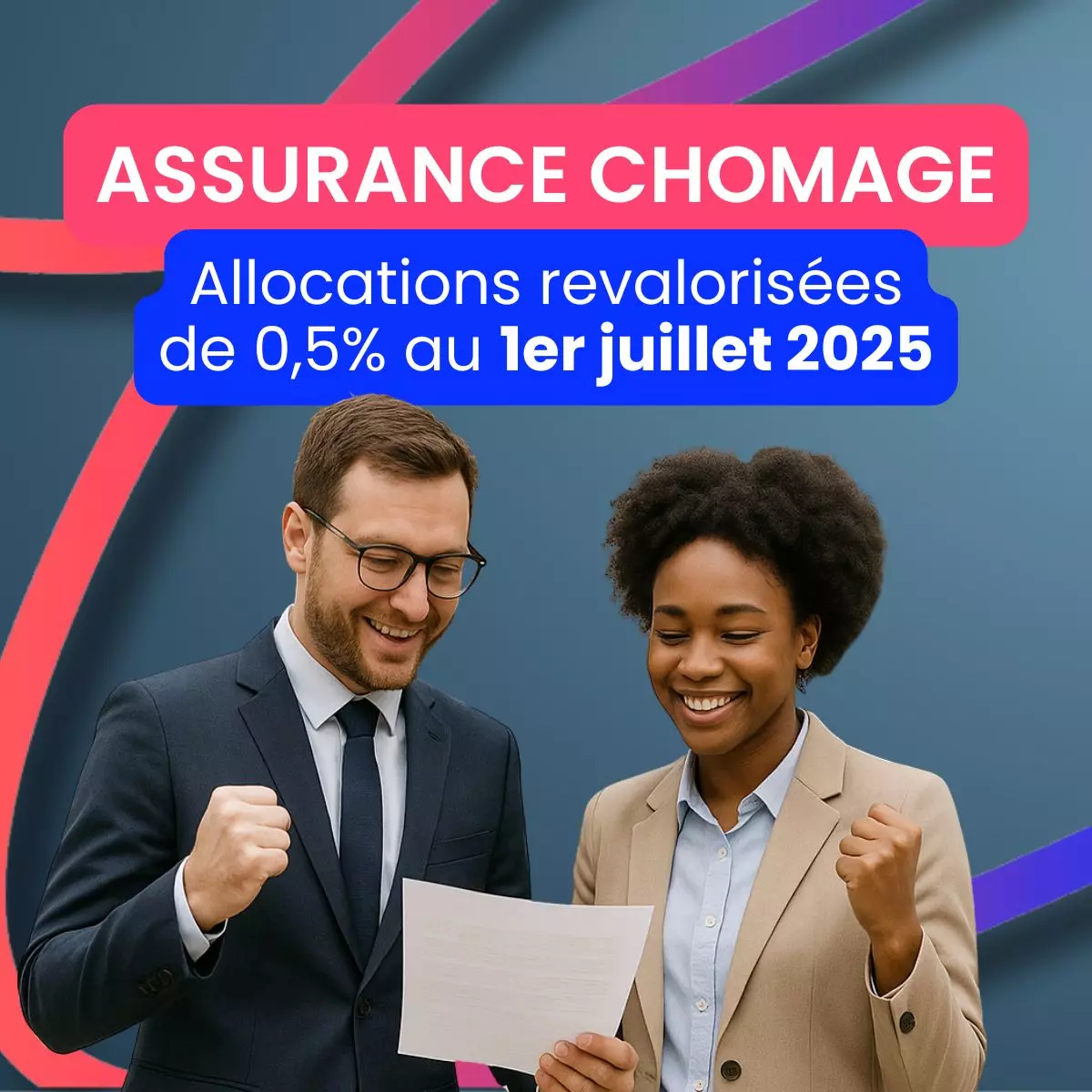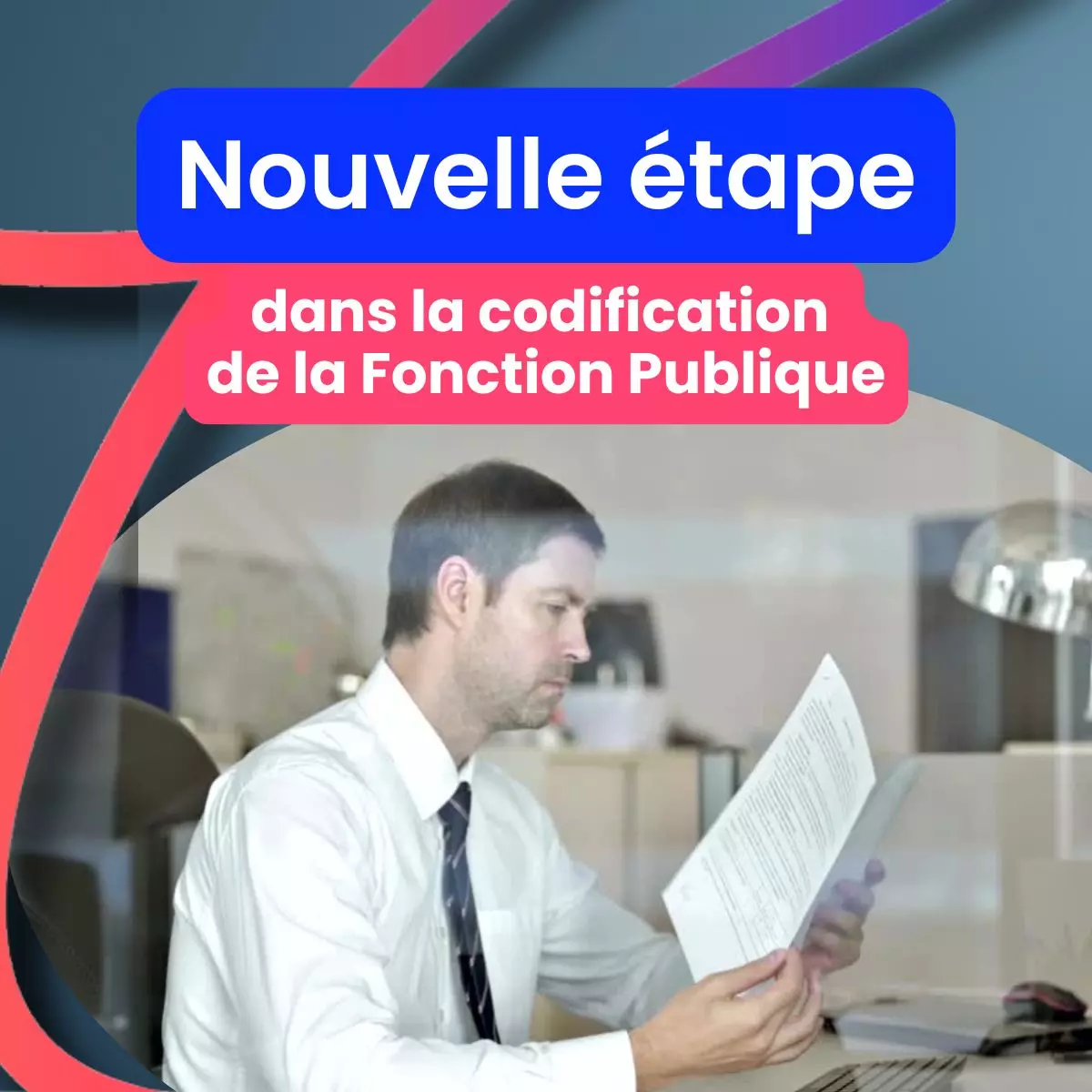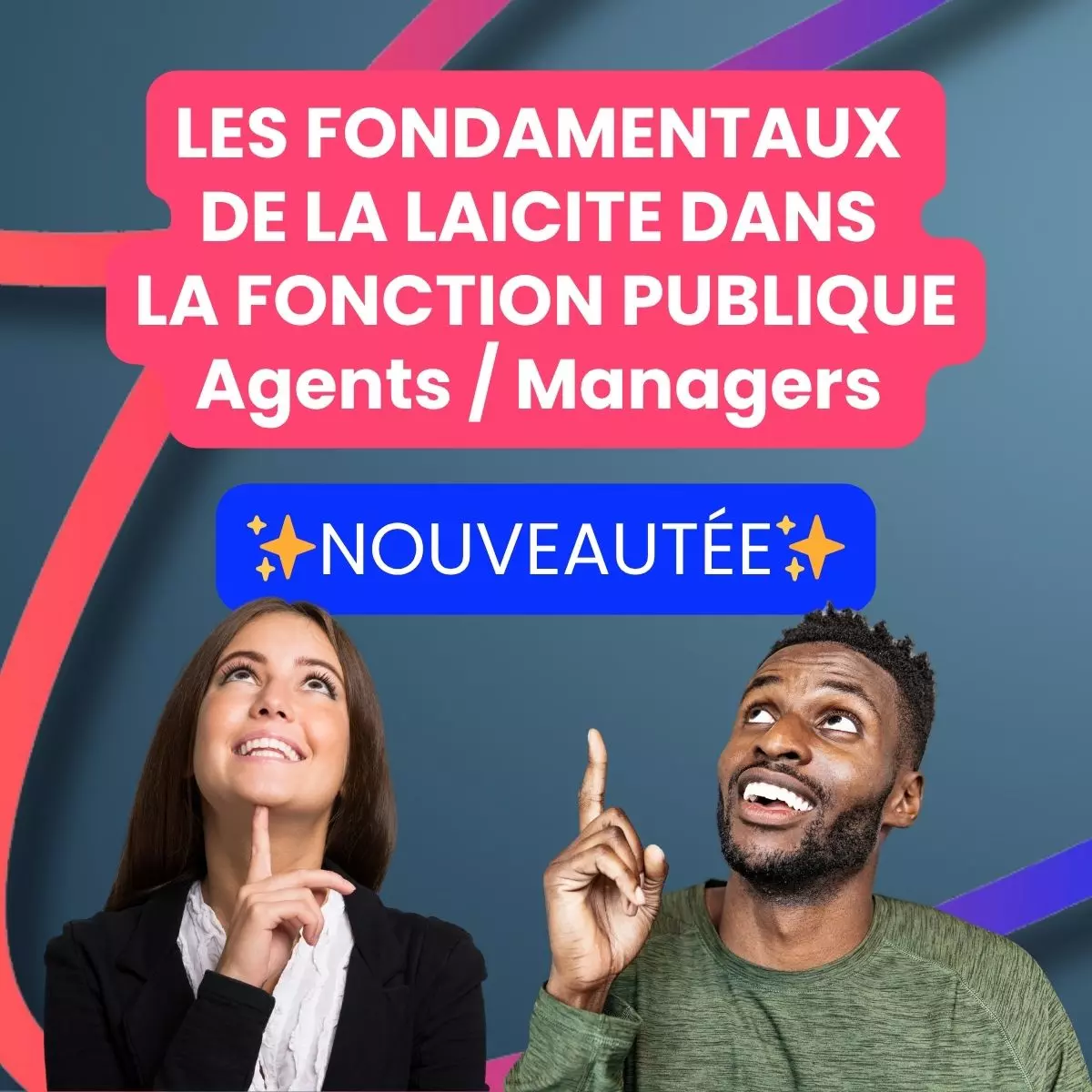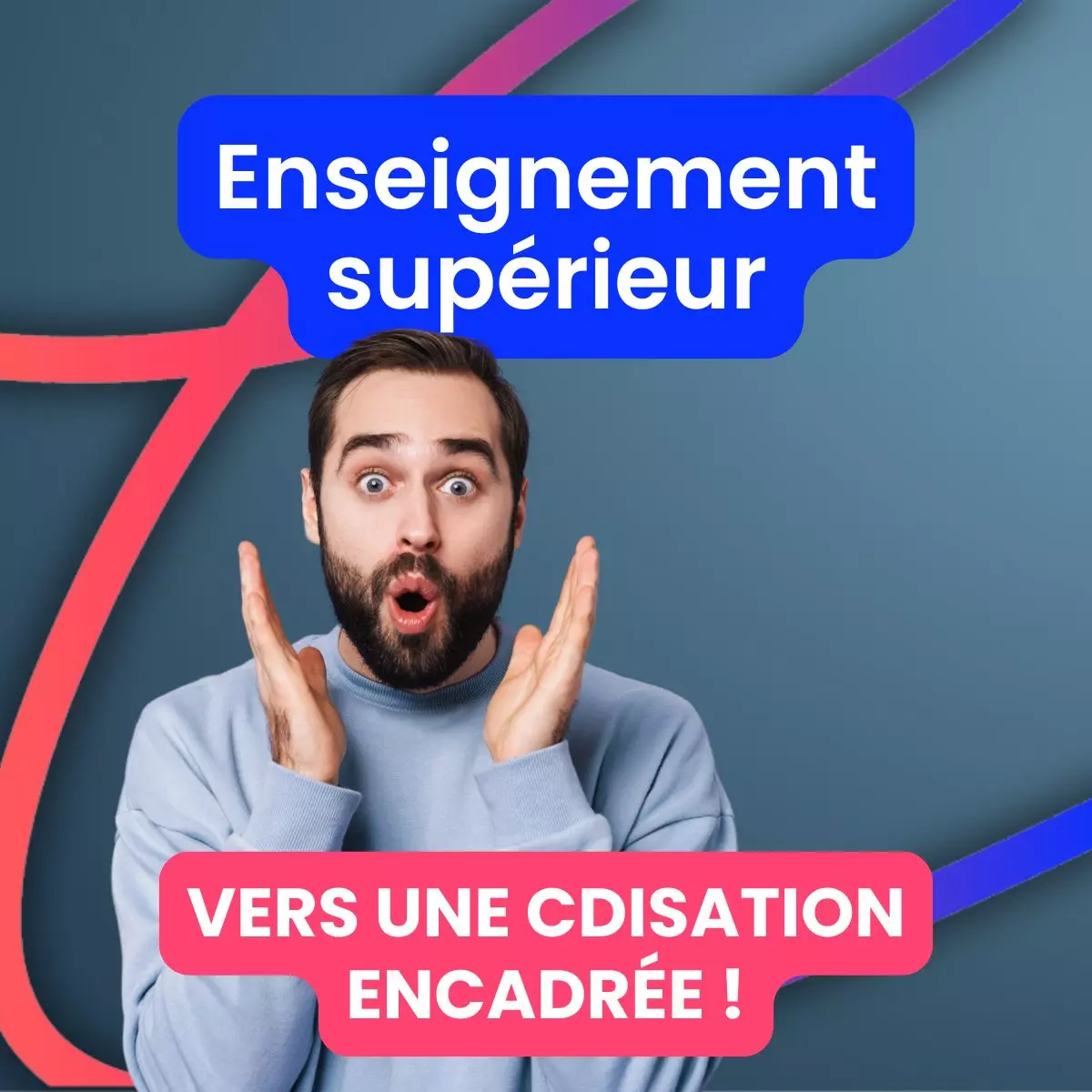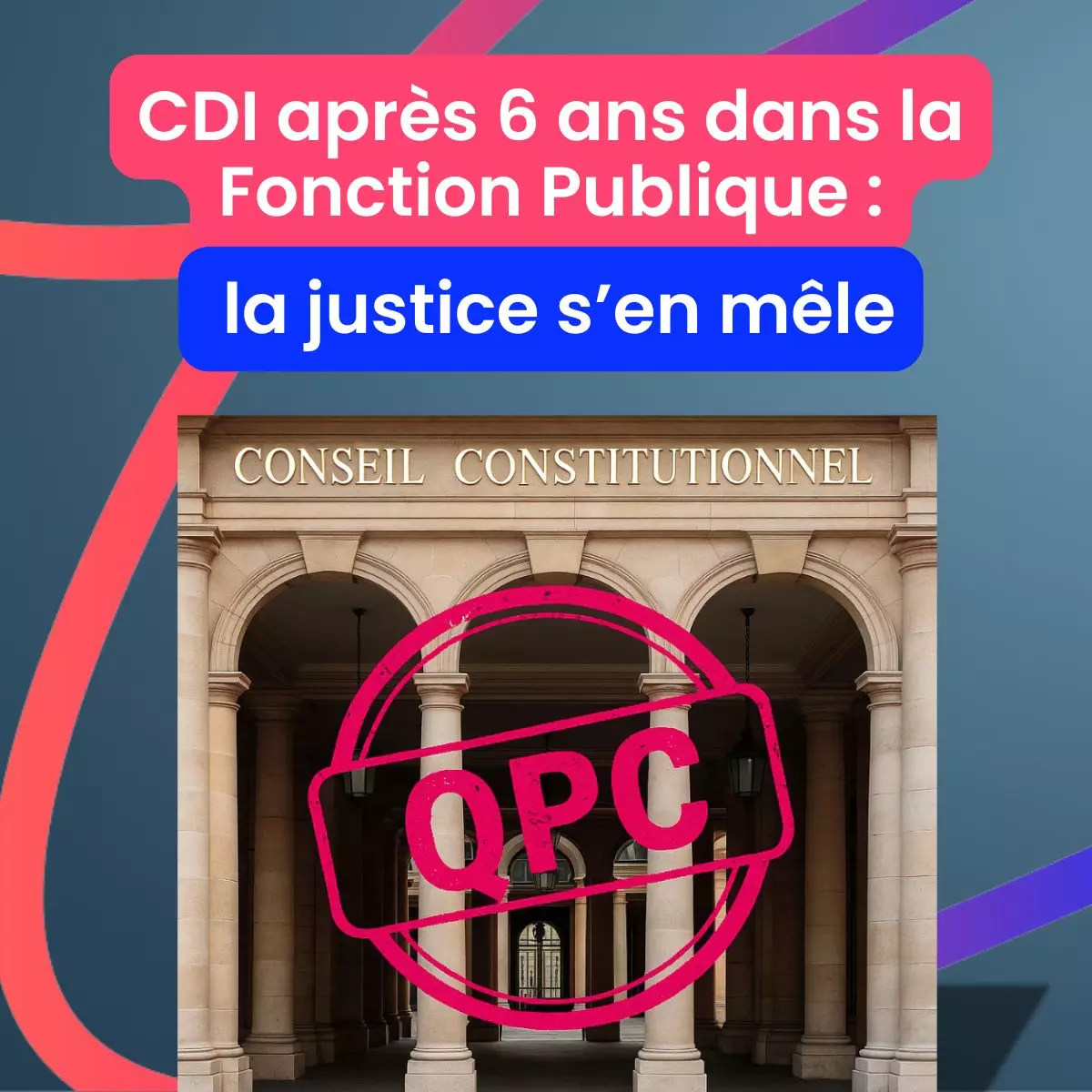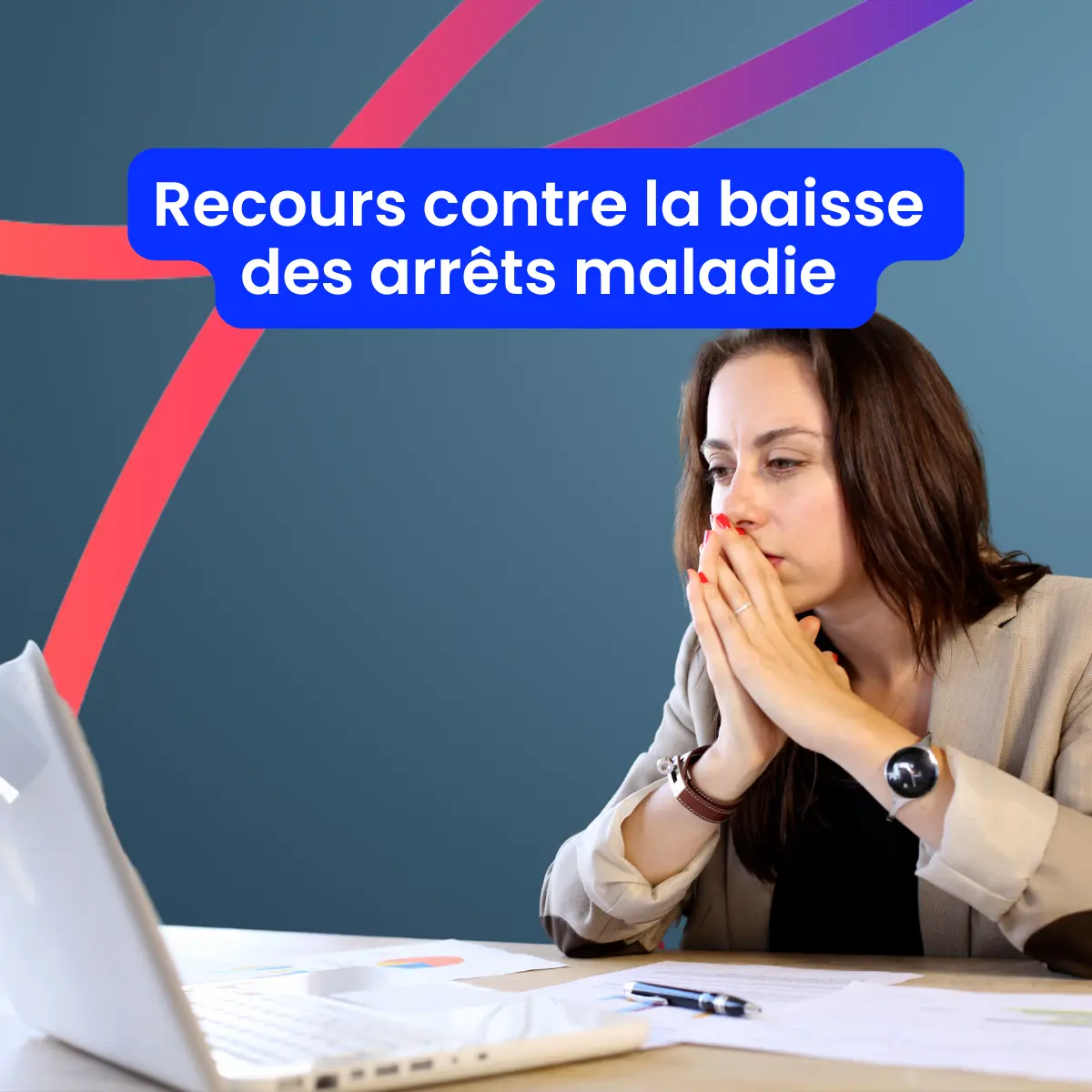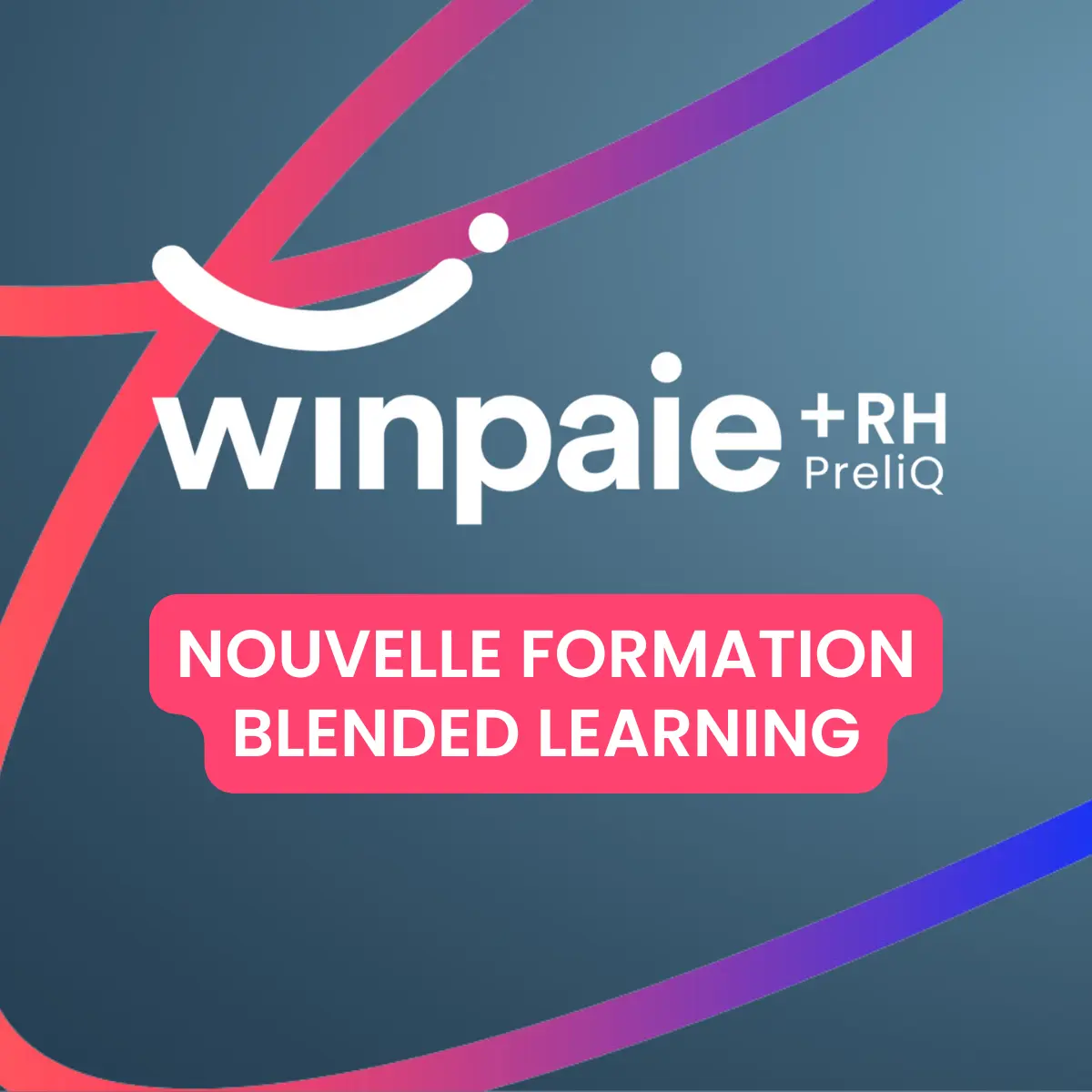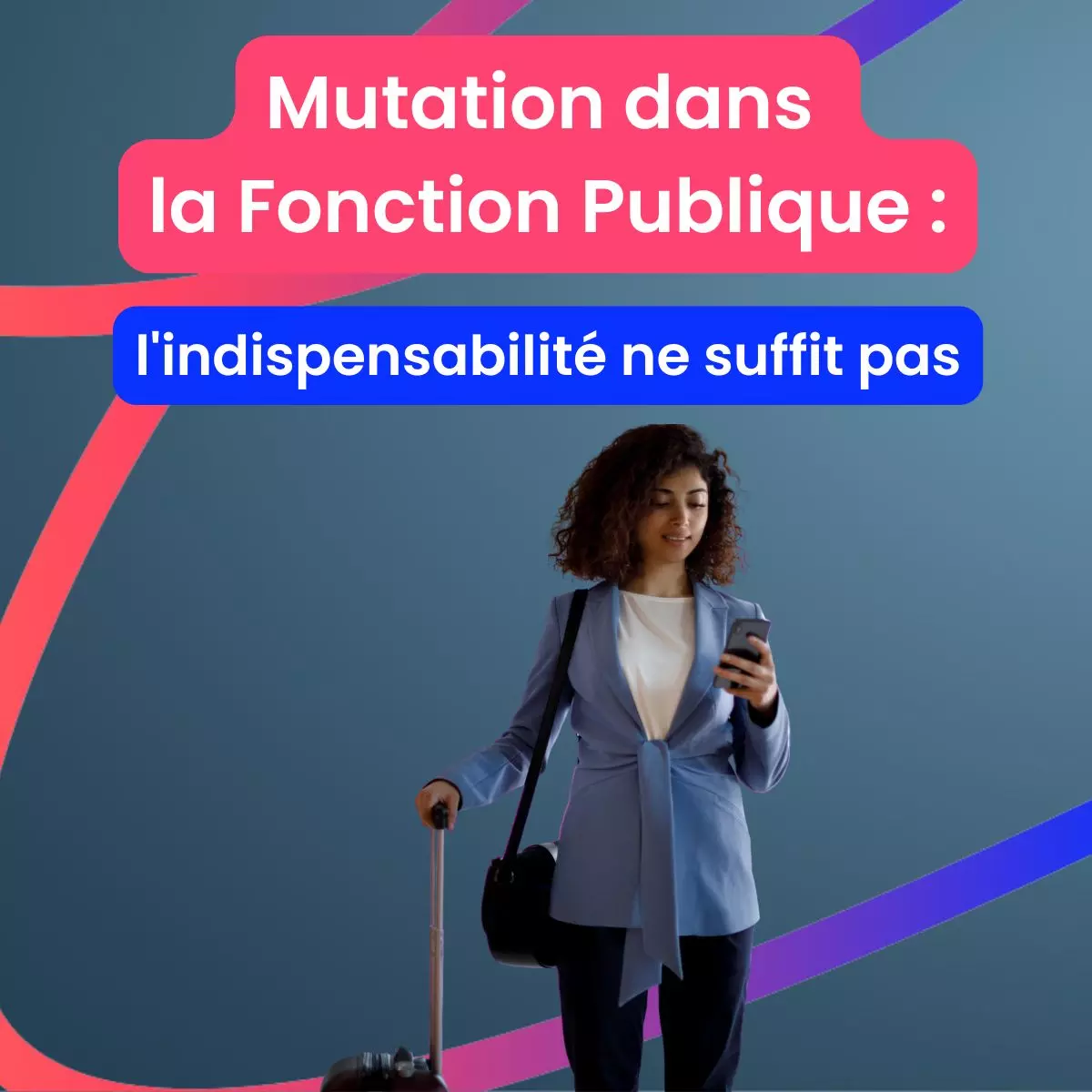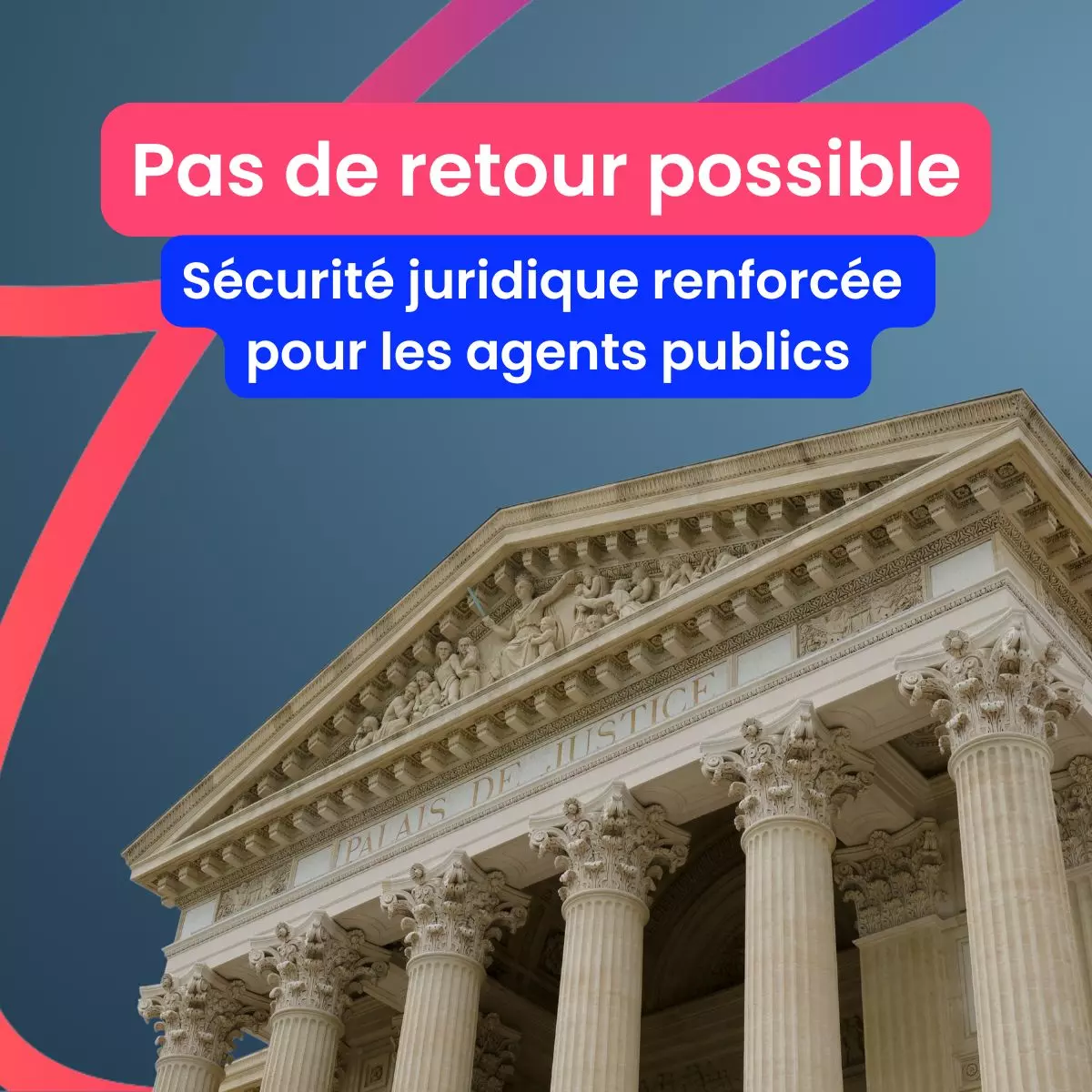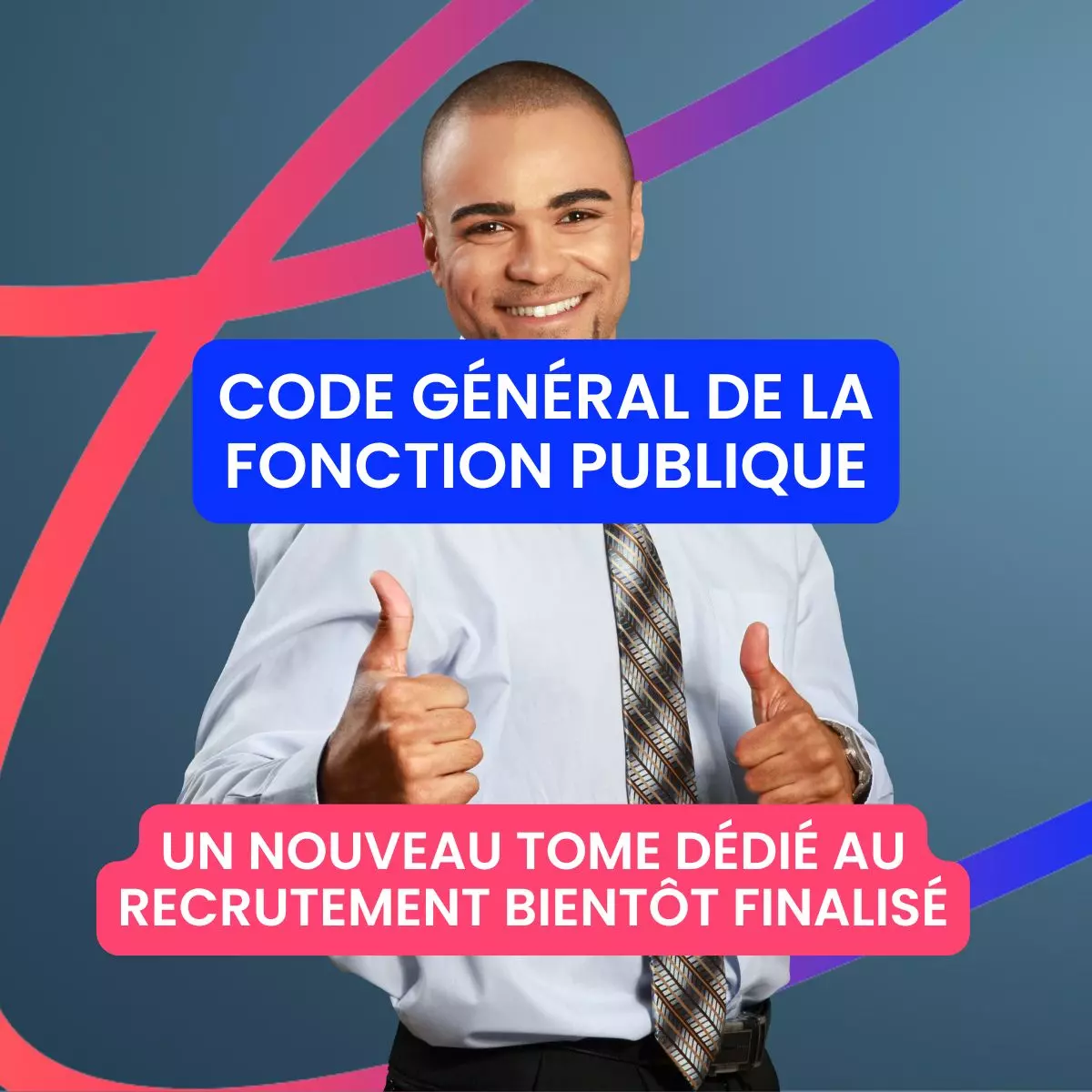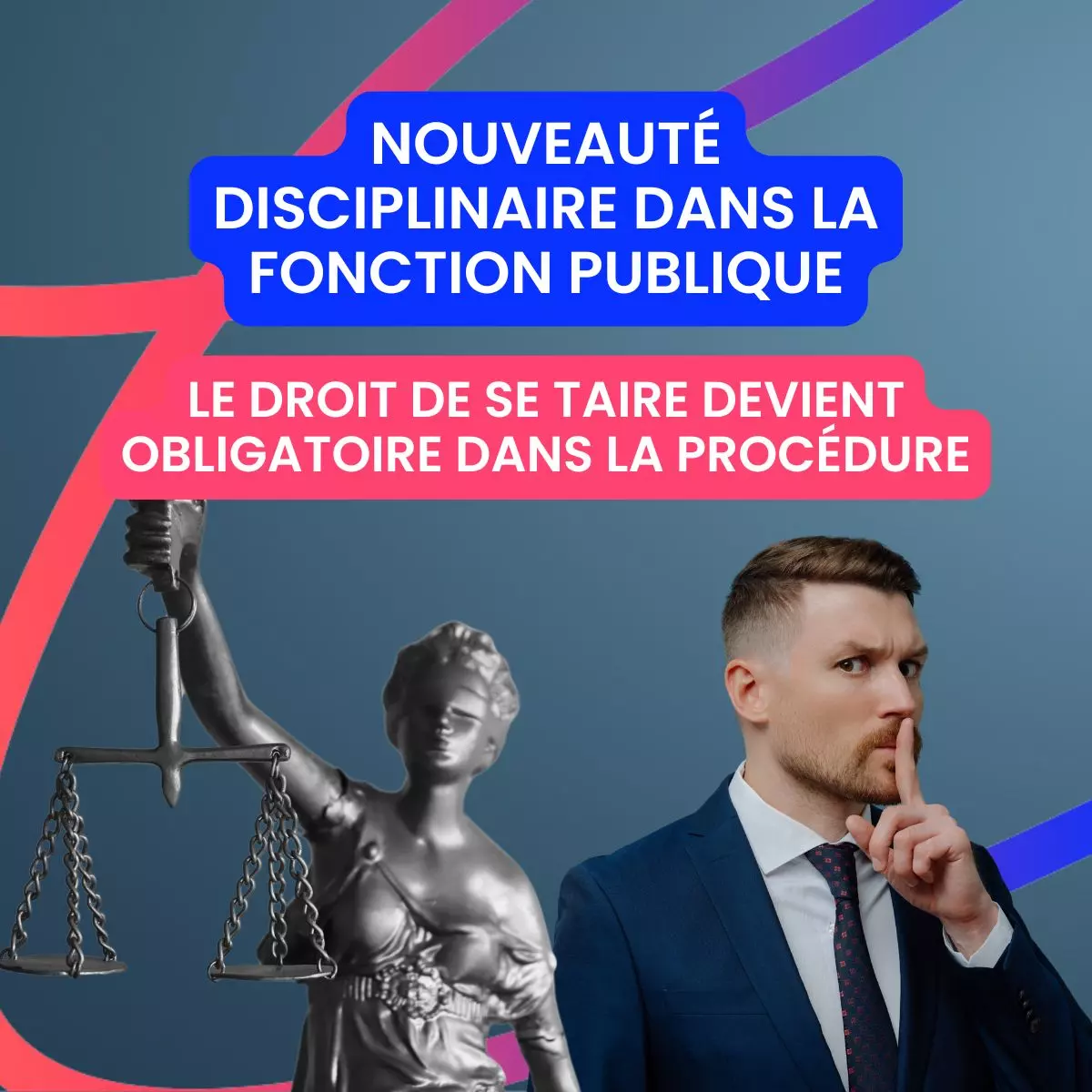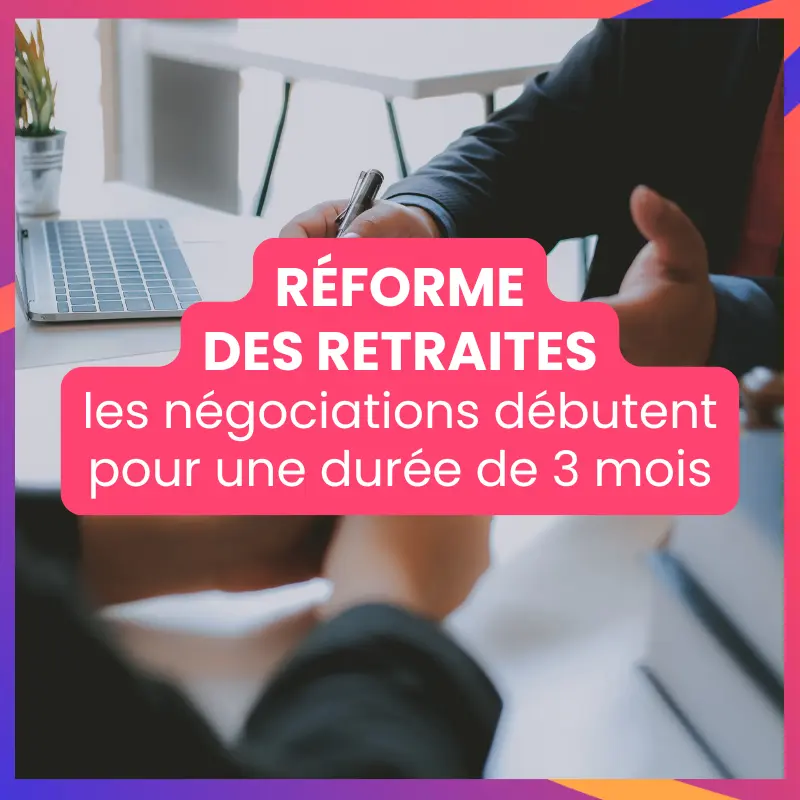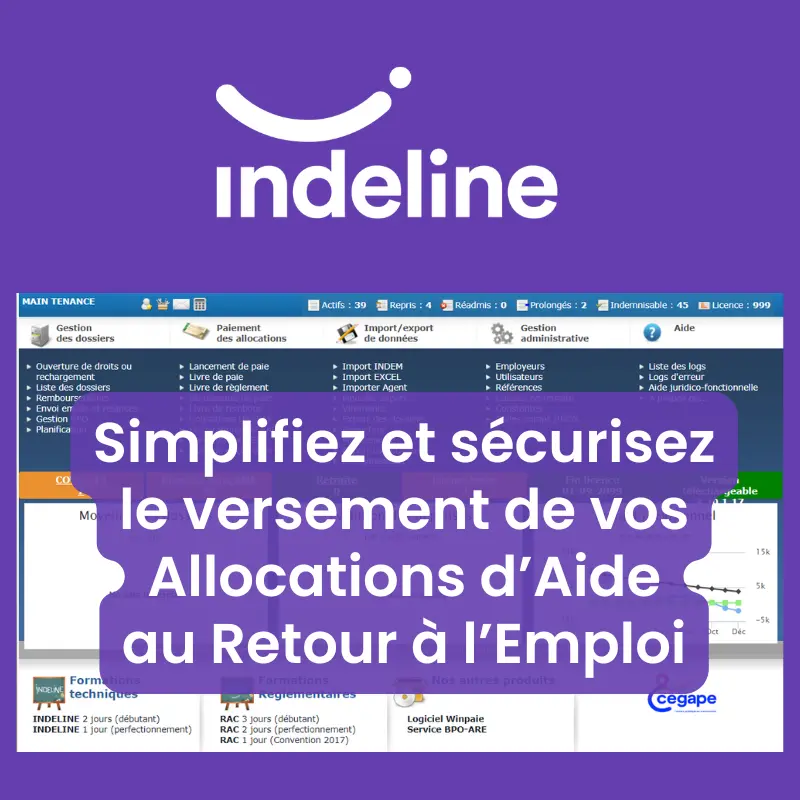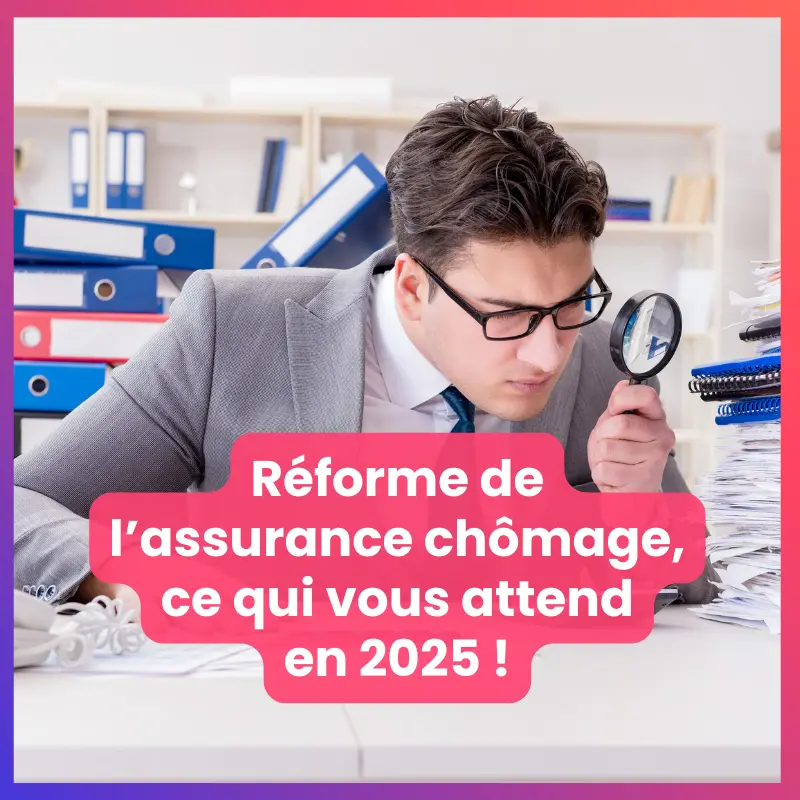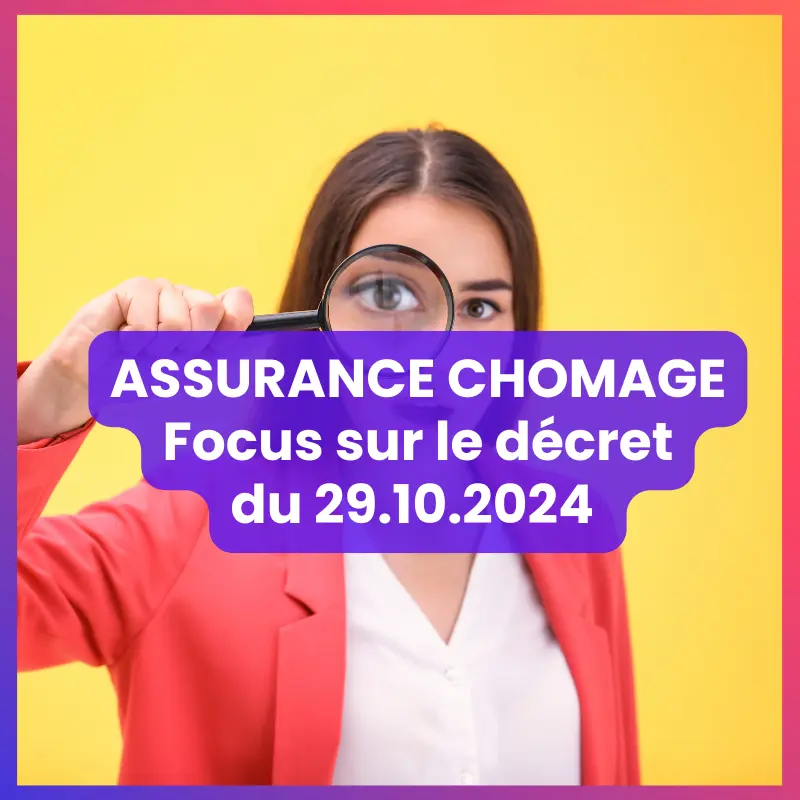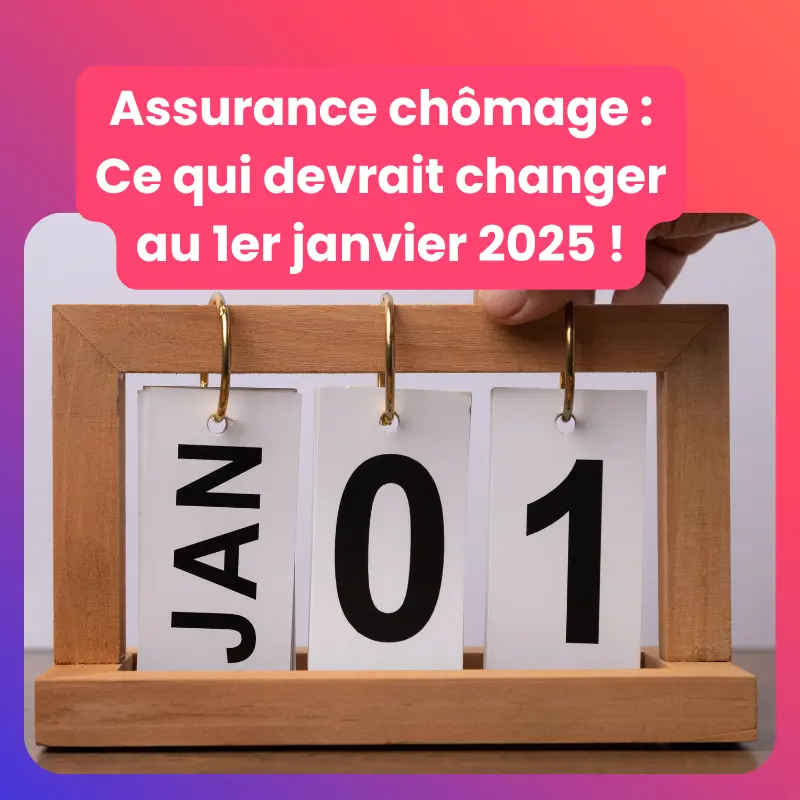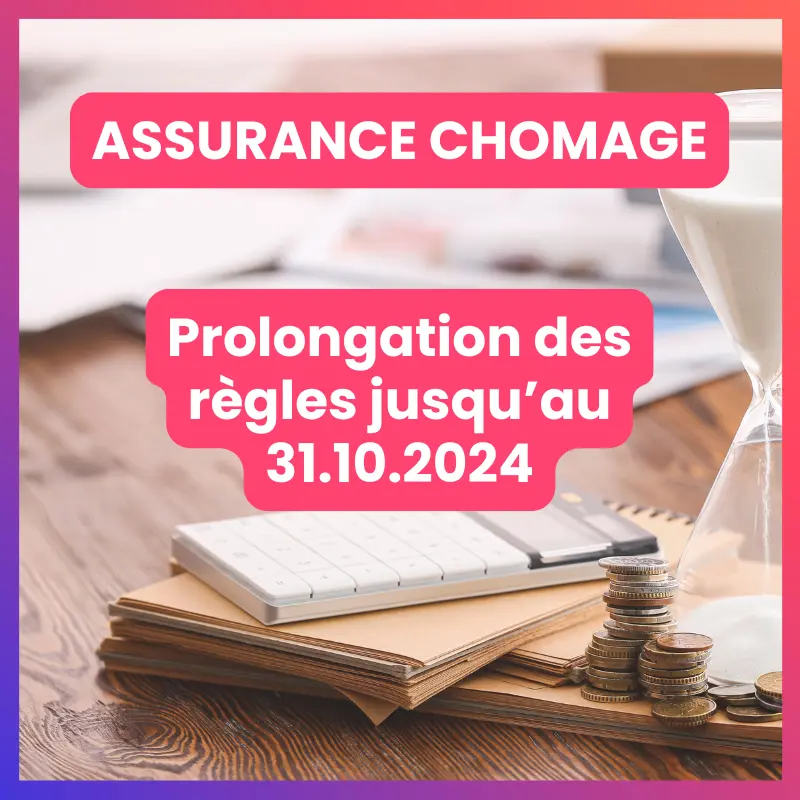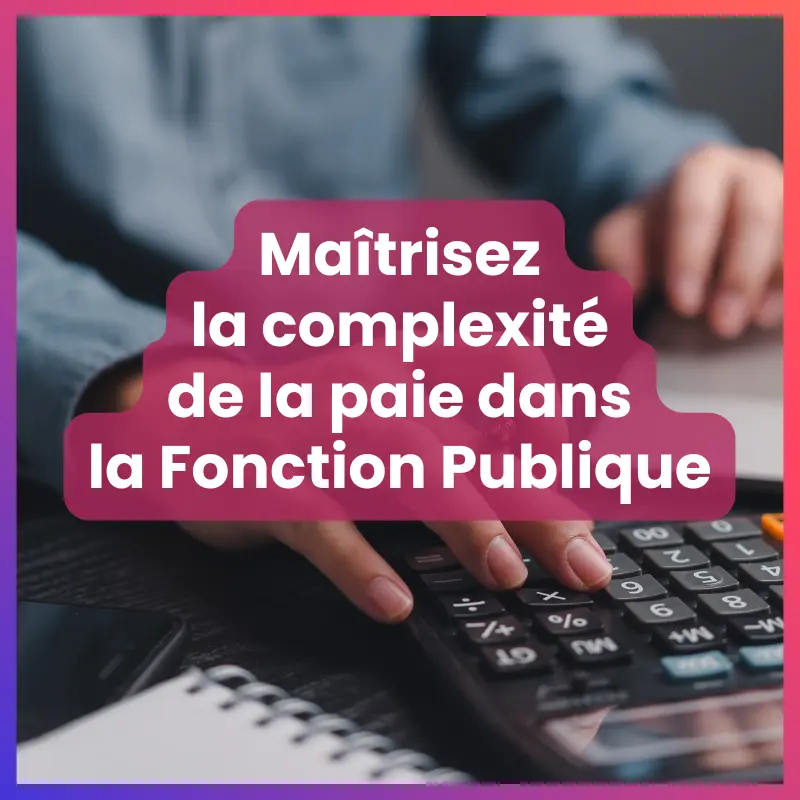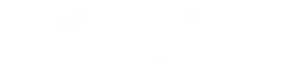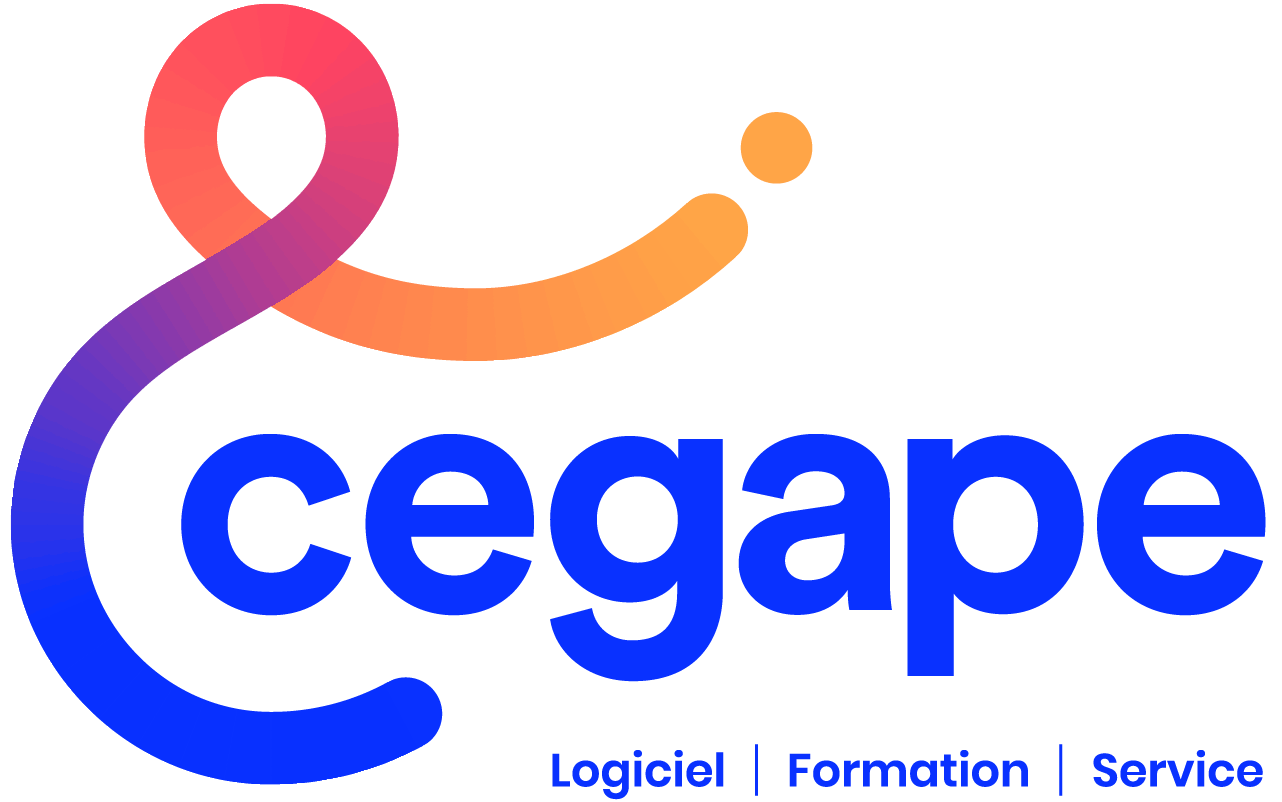En application de l’article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique, le Gouvernement a transmis à l’Assemblée nationale et au Sénat un rapport relatif au bilan de l’expérimentation de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires.
Le rapport établit un bilan contrasté. Il relève des aspects positifs et souligne des « effets d’aubaine », des dérives qu’il convient d’encadrer. Le rapport note également des disparités au niveau des ministères qui méritent des adaptations. Enfin, la rupture conventionnelle des fonctionnaires qualifiés est un enjeu majeur pour plusieurs administrations.
Malgré ces aspects négatifs, le Gouvernement envisage la pérennisation du dispositif pour les fonctionnaires et l’adoption de nouvelles dispositions en vue d’encadrer les dérives. Avant le 31 décembre 2025, date d’expiration de l’expérimentation de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires, le Gouvernement devra trouver le support législatif pertinent pour atteindre ces objectifs.
Une expérimentation qui bouscule les pratiques RH
Depuis son lancement, ce dispositif a permis à de nombreux agents de quitter leur poste de manière concertée et indemnisée, offrant un levier inédit de mobilité et de reconversion dans la Fonction Publique. Pour les employeurs publics, la rupture conventionnelle a parfois été perçue comme un outil de gestion des effectifs ou de prévention de situations RH complexes.
Mais le rapport souligne aussi un recours inégal selon les ministères, et l’absence d’un cadre suffisamment normé pour éviter certaines dérives, notamment des départs juste avant la retraite ou sans projet réel de reconversion.
Des chiffres qui révèlent des usages bien identifiés
Depuis sa mise en place, le dispositif de rupture conventionnelle a connu une montée en puissance rapide, avec un pic d’attributions en 2021, avant de légèrement décroître en 2022 et 2023. En 2023, ce sont près de 2 000 indemnités spécifiques de rupture conventionnelle (ISRC) qui ont été versées.
Le profil type des agents concernés se précise : 70 % sont des femmes, avec un âge moyen de 47,4 ans, ce qui confirme un usage concentré sur des carrières déjà bien engagées.
Par ailleurs, 75 % des ruptures conventionnelles concernent trois grands ministères : l’Éducation nationale, l’Enseignement supérieur et la Recherche, témoignant de disparités importantes entre administrations.
Ces chiffres appellent à une harmonisation des pratiques et à un encadrement renforcé pour garantir l’équité du dispositif.
Quelles suites en 2025 ?
La fin de l’expérimentation approche : si le Gouvernement souhaite généraliser ce dispositif, il devra intégrer un encadrement renforcé pour éviter tout détournement, tout en préservant la souplesse attendue par les agents et les services.
Ce travail devra aussi permettre de mieux accompagner les départs de profils qualifiés, enjeu majeur pour certaines administrations qui peinent déjà à attirer et fidéliser leurs talents.
🔗 Consultez la source officielle du rapport
Et du côté des employeurs publics, comment s’adapter ?
Face à la probable pérennisation de la rupture conventionnelle, les services RH doivent anticiper les évolutions à venir : sécuriser les procédures, accompagner les agents concernés et intégrer ces mobilités dans une gestion prévisionnelle des effectifs plus stratégique.
👉 Pour approfondir ces thématiques et maîtriser les dernières évolutions réglementaires, Cegape propose plusieurs formations en lien avec les dernières actualités et jurisprudences en matière de gestion du statut et de la carrière :
Fonction Publique
Rupture conventionnelle
Ressources humaines
Mobilité des agents
Réforme RH




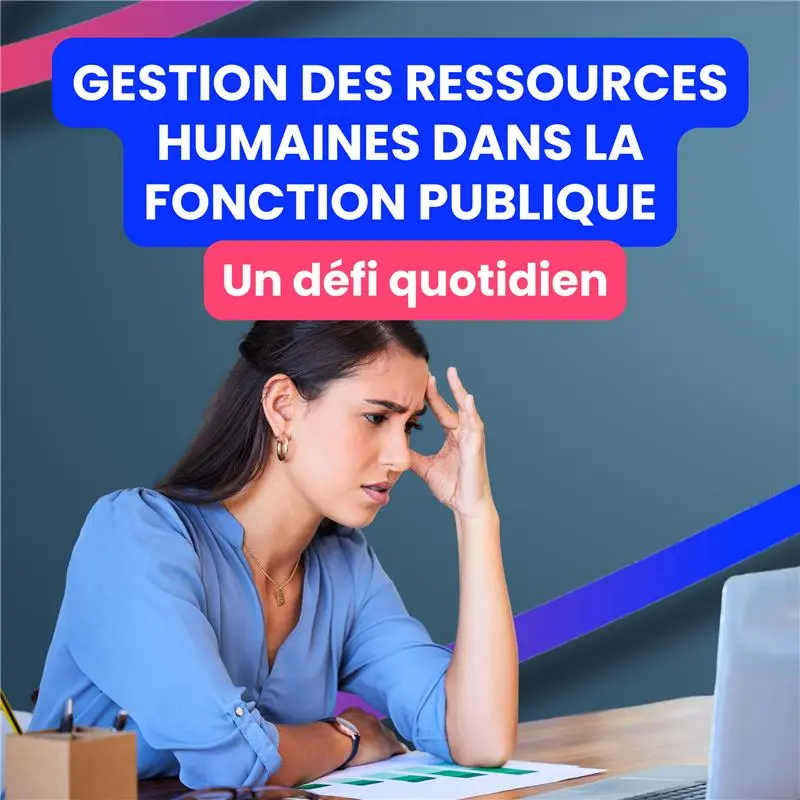
 Valentine Weiss
Valentine Weiss